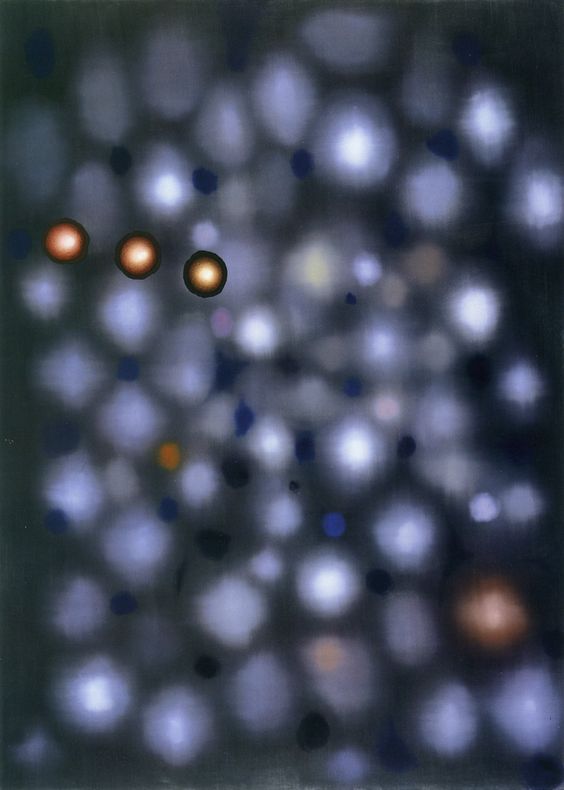Dès le début de notre parcours, une surprise nous attendait : en elle-même, la vie ne représente pas vraiment une valeur. On n’a pourtant qu’une vie et c’est, après tout, tout ce que nous avons. Mais non ! Parce que la mort est la seule certitude commune à tous les hommes, il est étrange qu’elle ne puisse rien sur eux, note Nietzsche. Il est étrange qu’ils ne tirent rien de cette fraternité de la mort. Pas même le constat que la vie est digne d’être pensée (Le gai savoir, 1882, § 278). Couramment, en effet, la vie ne semble pas suffire. Il faut lui trouver une valeur supérieure. On pourra ainsi souligner que la vie s’est déployée dans des formes d’organisation dont la luxuriance, la diversité, la complexité défient assez largement l’imagination. On pourra reconnaître qu’elle chemine, de manière progressive, à travers une évolution, vers une fin qui nous dépasse. On pourra enfin poser que la vie nous est comme un legs que nous avons la charge de faire fructifier et que la simple vie ne saurait nous suffire ainsi mais qu’il nous faut une bonne vie, une vie accomplie, cela seul permettant de surmonter la perspective de la mort.
Ou alors, pour régler la question, il faudra tenir un discours strictement opposé. Dire que la vie n’est rien. Qu’elle n’existe d’ailleurs même pas, au titre d’une quelconque réalité à part mais ne représente qu’un arrangement particulier de la matière. Que sa complexité n’est qu’un épiphénomène, qui se réduit à quelques déterminismes simples finalement. Que l’évolution, quant à elle, ne va nulle part. Livrée au hasard, elle voit réduire ses propres possibilités sous la pression de l’adaptation. Que la finalité du vivant, enfin, est une niaiserie. La vie détruit autant qu’elle produit et la mort est le seul horizon pour des êtres qui ne sont que des accidents. Tandis qu’est simplement dérisoire le jeu de récompenses et de châtiments que nous imaginons nous attendre au delà d’elle.
Au cours des sections précédentes, nous n’avons cessé de rencontrer ces deux points de vue, finalement très proches en ce qu’ils représentent des jugements extérieurs à la vie, discutant du sens que l’on peut lui prêter et des valeurs qu’il faut lui reconnaître. Des jugements formulés en termes de tout ou rien. Des jugements de valeur qui reviennent donc à opposer la vie à l’esprit, comme si ce dernier ne dépendait pas d’elle, n’était pas elle – de sorte que le crime qui anéantit la vie puisse passer pour une affirmation radicale de l’esprit, comme le suggère Yasunari Kawabata dans son roman La beauté, tôt vouée à se défaire (1933).
La vie éblouit dans ses créations, ses prouesses et ses organisations. Seule et nue, elle représente aussi bien une inévitable déception, par sa prolifération incontrôlée, par ses gâchis incessants, par sa fragilité. Entre les deux, il faut choisir son parti. La vie sollicite un acte de foi. Qu’importe qu’on la comprenne encore si mal : dans son origine, son organisation, son évolution. L’attentisme, ici, n’est pas de mise. Il faut décider de ce que représente la vie. Car derrière elle les enjeux ne sont pas minces : il y a Dieu, la Providence, le sens de notre existence, la place de l’homme dans la nature et bien d’autres choses encore. Ces thèmes, de fait, sont certainement aussi présents de nos jours qu’aux XVII° et XVIII° siècles – qu’on lise donc à cet égard les ouvrages de Monod, Gould ou Dawkins, parmi beaucoup d’autres. Et au vu de tels enjeux, il est difficile de ne pas pré-juger de la vie.
La vie pose un problème. Parce que penser la vie, c’est penser à l’échelle de toute la nature. Si la vie représente un idéal, en effet, nous le partageons avec l’amibe ! Il est difficile de reconnaître là notre destination la plus haute. Aristote écarte ainsi le fait de vivre de la recherche du Souverain Bien, puisque le premier n’est en rien propre à l’homme mais est ce que ce dernier partage en commun avec les végétaux (Ethique à Nicomaque, I, 6).
On ne rencontre guère de philosophies fondées sur une notion de vie entendue, ainsi que le pose Alfred North Whitehead, comme un certain absolu dans le plaisir d’être soi-même ou self-enjoyment (La nature et la vie, 1934). Fichte est sans doute celui qui est allé le plus loin dans cette voie avec sa Méthode pour arriver à la vie bienheureuse (1806). Car la vie est nécessairement bienheureuse, affirme Fichte. La vie est contentement, jouissance de soi-même. Elle est amour en ce sens. Ainsi, ne pas savoir ce qu’on aime, c’est ne pas vivre vraiment, ajoute Fichte. Et voici la vraie vie opposée à la simple vie, dont Fichte reconnaissait pourtant le caractère le plus profond peut-être : la possibilité d’atteindre sa fin en elle-même. Mais cela n’est pas encore vraiment la vie à ses yeux. Pour arriver à la vie, écrit-il, le fini doit passer par la mort, se détacher des objets pour les retrouver revêtus d’une beauté idéale. C’est que nous sommes l’existence divine – car dire que Dieu existe, extérieurement à nous, c’est le néantiser. Voilà la destination de la vraie vie, face à laquelle la simple vie n’est presque rien, presque morte.
On a maintes fois loué et représenté la bonne, la grande vie. A partir du Romantisme ont a même voulu que la vie soit exaltée et exaltante. La vie ? Pas n’importe laquelle. La vraie vie. Celle qui est ailleurs. Qui nous échappe la plupart du temps. Forcément. Une vie qui s’oppose à la vie comme elle va et la dépasse, comme si notre simple vie ne pouvait suffire. Une revendication exigeante qu’on ne saurait confondre avec la plate attente d’un simple bonheur – tant il est facile d’être heureux avec un cœur sec et un esprit borné, affirme Hölderlin (Hypérion, 1797, p. 94). Les peuples heureux, c’est bien connu, n’ont pas d’histoire.
L’exaltation du vivre voit volontiers dans la passion, la lutte et l’épreuve la clé d’une vie supérieure et elle comprend ainsi si mal la vie qu’elle est incapable de reconnaître la paix comme la première et plus fondamentale aspiration à l’épanouissement du vivant. Car, rançon de sa félicité à être lui-même, le vivant est, comme dans l’extraordinaire nouvelle Le terrier de Kafka, un être anxieux de protection, que sa fragilité enferme dans une solitude irréductible et qui, se retrouvant sans défense, rêve d’un repos paisible, la récompense d’un honnête labeur. C’est dans cet espoir de vivre sans doute, aussi étroit soit-il, que la vie se laisse le mieux saisir. Dans son avion de guerre en péril au dessus d’Arras : « c’est comme si ma vie m’était à chaque seconde donnée », note Antoine de Saint-Exupéry. « Je ne suis plus qu’une source de vie » (Pilote de guerre, 1942, p. 174). C’est en péril, souffrants ou mourants que nous pouvons nous découvrir vraiment vivants. Nous sommes alors pitoyables. Et pourtant… Dans un très fort témoignage, une femme, Grisélidis Réal, rongée par le cancer, tordue de souffrance et réduite à cet état terminal où “on rêve qu’on est encore vivant” (p. 327), écrit, alors qu’elle sait qu’il ne lui reste que quelques jours à vivre : quand je pense à demain, je suis heureuse de tout, de cette attente, du mystère de l’attente… (Les sphinx, 2006, p. 346). Voilà la vie réduite à sa plus pure expression sans doute : l’espoir d’être au monde. Un espoir fou et assez dérisoire dès lors qu’il est tendu au dessus du précipice, en même temps qu’immense puisqu’il fait du monde comme son aliment. Derrière l’effroi du mourir, le plaisir d’arriver, écrivait Antonio Machado. Echappant assez miraculeusement à un peloton d’exécution, Maurice Blanchot a décrit la sensation de légèreté, presque d’allégresse qu’il ressentit à l’instant de sa mort (L’instant de ma mort, 1994).
Alors que la vie va s’éteindre, il y a encore l’espoir de retrouver le monde qui miroite comme une promesse dans l’attente. Comme si c’était lui, au fond, qui menaçait de disparaître ! Notre vie est notre finitude car, si nous sommes vivants, c’est au bout d’un processus qui nous déborde et à travers lequel les vivants organisent la matière sous une forme capable d’être transmise au-delà d’eux-mêmes. Notre vie ne peut donc être pleinement dite, dans la mesure même où nous existons sous une certaine détermination qui nous précède. On peut le comprendre mais cela ne revient pas à percer quelque mystère de la vie. Seulement à être attentif au fait que nous sommes vivants. La vie, c’est moi monté dans un bateau. Je le dirige mais il me transporte. Mais c’est moi, monté sur ce bateau, qui fait qu’il est comme un bateau, écrit Maître Dogen (Zenki/La totalité dynamique, 1243). Voilà toute la vie ! Il n’y a pas là un mystère recelant la raison qui profondément nous agit et nous fait être.
Du vivant, dès lors, que pouvons-nous retenir ? Ceci, certainement, que le caractérise une capacité à se maintenir, à agir, à se modifier et à se reproduire dans l’échange organisé avec son milieu. On a souvent traduit ces différents caractères en parlant d’une spontanéité vitale. Bien qu’il s’agisse là d’une idée mal commode, le propre du vivant serait d’être “auto-mobile”, c’est-à-dire capable d’initier et d’orienter lui-même ses mouvements. Cette caractérisation du vivant par sa spontanéité nous est immédiate : la possibilité d’initier son propre mouvement est certainement le critère qui nous permet le plus couramment de distinguer ce qui est vivant de ce qui ne l’est pas. Or c’est là pourtant déjà une interprétation. Et c’est non tant un constat qu’un problème, car ce qui fait ainsi le propre du vivant est un principe d’autonomie dont le statut ne peut qu’être problématique, puisqu’on le conçoit précisément comme la capacité de marquer un certain affranchissement par rapport au monde ; au point d’inviter facilement à croire que la vie se fonde sur un principe immatériel. Dans la science du vivant, beaucoup de grands débats ont tourné et tournent encore autour de cette caractérisation – qui repose pourtant sur un vaste malentendu.
Car, reposons notre question : du vivant, que devons-nous retenir au minimum ? Sauf à lui ôter toute réalité propre, il faut reconnaître que ce qui est vivant introduit au sein de la matière une discontinuité. Non qu’il échappe aux lois physiques. Non qu’il relève de quelque principe immatériel. Mais parce que son organisation est capable de se reproduire au sein d’un milieu donné, c’est-à-dire de se maintenir en adaptant ses actions jusqu’à un certain point et d’engendrer un autre vivant qui lui ressemble et propage ses principaux traits, chaque être vivant doit être reconnu comme un centre d’activité singulier au sein de la matière. Et il faut lui reconnaître une finalité aussi bien : celle de se prolonger. A défaut de ces deux caractérisations, il deviendrait très difficile de savoir ce que l’on désigne par “vivant”. Et qu’on ne nous oppose pas les robots ! Nous avons souligné à quel point ils sont éminemment « vivants ».
Ne parlons donc pas de spontanéité, ni même d’autonomie, car c’est déjà poser le problème en termes d’organisation physique. Ne disons pas davantage et pour la même raison qu’est vivant un être qui doit être reconnu comme l’origine d’un mouvement et comme capable d’un effort. Disons que le vivant force à introduire dans l’être le registre de l’individualité, à travers une portion de matière organisée en spontanéité et mémoire – car notre code génétique est précisément cela : une mémoire. Or, si un vivant est le porteur d’une mémoire singulière ou le porteur singulier d’une mémoire commune à plusieurs individus (tous les vivants, comme les jumeaux vrais, ne disposent pas d’un code génétique original), on ne peut comprendre le vivant comme tel que dans son rapport à ce qui n’est pas lui : au monde, à son milieu, qui comprend d’autres vivants. Et ce rapport même le constitue comme individu particulier.
Il n’y a pas, en d’autres termes, de vivant en soi. Pas de vivant en général. La vie ne s’investit que dans des êtres individuels. Et, à ce niveau, notre science est largement impuissante : comment une telle individualité a-t-elle pu apparaître ? Comment l’individualité vivante a-t-elle pu se déployer sous un foisonnement de formes singulières, quoique composées de myriades de cellules vivantes et se laissant par ailleurs rassembler à un autre niveau de fragmentation : l’espèce, le genre ? Quoi qu’il en soit, l’individualité vivante paraît radicale. Chaque vivant, sous différentes formes et aussi infime soit-il, introduit dans le monde une discontinuité – au moins en ce qu’il renferme une mémoire propre et codée qui ne peut se déployer sans ce support individuel. A partir de là, il faut aller encore plus loin et dire qu’il est ainsi au moins un aspect qui rassemble tous les vivants : dans la mesure même où il est individué, chaque vivant est un centre de valeur.
Cela ne doit pas être confondu avec quelque détermination physique positive. C’est là seulement une catégorie de penser qui ne peut manquer d’apparaître face à la réalité vivante, puisqu’une individualité ne se définit jamais comme telle que dans un écart avec le reste du monde. Par cela même qu’elle existe, elle n’est que dans l’exacte mesure où elle défend et tente de faire valoir sa particularité. Par cela seul qu’il est, un individu est donc immédiatement valeur. Il a la valeur d’une particularité, dont sa vie représente l’affirmation. Il a la valeur universelle d’être singulier. Dit autrement, il peut y avoir une idée singulière d’un être non-vivant, un jouet par exemple, que sa nature physique peut suffire à distinguer d’autres, semblables à lui, ou simplement ses coordonnées extérieures uniques dans l’espace et le temps. Mais un tel être ne va pas de lui-même se prendre pour fin pour tenter de s’affirmer et de se prolonger dans le monde. Dès lors, toute la difficulté est de comprendre que si cela seul dote le vivant d’une valeur sui generis, cela ne peut être une cause car il s’agit là non d’une réalité physique mais de l’appréciation intelligente d’une réalité. A travers ses mouvements, le vivant se pose comme valeur mais seule l’intelligence peut reconnaître cette valeur. Elle n’existe que pour un esprit. Au sens où, comme le note Raymond Ruyer, il n’y a de corps que pour d’autres corps – nous n’avons pas de corps, sinon pour les autres qui, nous voyant, nous transforment en chose vue et c’est aussi bien comme chose que nous regardons notre propre corps, comme s’il était différent de nous (La Gnose de Princeton, 1974).
Bien sûr, on pourra être tenté de dire qu’une telle valeur n’existe pas et n’est qu’une interprétation. Mais on ne comprendra alors plus rien du tout au vivant. Il faudra dire qu’il n’existe pas. Les êtres vivants ne seront qu’une matière à laquelle le hasard seul a donné différents attributs spécifiques pouvant faire croire à des comportements finalisés. A notre époque, la pensée commune du vivant en est à peu près là. Satisfaite, à ses yeux, d’avoir chassé le moindre soupçon de métaphysique, la moindre référence à un Dieu organisateur, sans se rendre compte – ou sans vouloir se rendre compte – qu’elle a fait ainsi du hasard un Deus ex machina !
Aucun être vivant ne représente une substance première née de rien mais est l’effet d’un jeu de lois naturelles – vivre suppose un acte de transmission et si nous sommes porteurs d’une mémoire, celle-ci nous précède toujours : elle est d’abord celle que représentent nos gènes. La science a ainsi appris à reconnaître que les vivants ne naissent pas de rien, qu’ils ne sont pas en eux-mêmes les sujets de l’évolution mais leur espèce au-delà d’eux, que leur nature dépend d’un code fait d’un assemblage de pièces dont l’ordonnancement chimique peut être réarrangé. Et l’être vivant, au total, paraît moins substance qu’effet. Admettre tout cela ne fait cependant perdre aux vivants ni leur caractère d’individu particulier dans le monde, ni la valeur singulière qu’ils en tirent. Le négliger conduit à nombre de débats absurdes, comme se demander, nous l’avons vu, à partir de quel nombre de cellules ou de semaines un embryon représente une personne. Comme si une telle caractérisation pouvait être liée à des déterminations physiques précises ; comme si elle correspondait à une substance matérielle singulière.
D’un point de vue physique, la vie est un phénomène matériel de mémoire qui se disperse en fragments. Parce qu’il porte et prolonge singulièrement une mémoire génétique, chaque vivant paraît doué d’une valeur individuelle. Ces deux aspects, quoiqu’inséparables, ne peuvent être confondus. Il est vain de chercher des valeurs renfermées dans l’ADN. Il est vain d’y chercher, codée, l’individualité – autant chercher le sens de cette présente phrase dans les circuits intégrés de l’ordinateur qui a permis de l’écrire ou la beauté d’un tableau à travers son analyse aux rayons X. Certes, en dernier ressort, cette beauté est affaire de couches et de pigments. Elle ne se situe pas à ce niveau néanmoins, puisqu’elle est inséparable d’un jugement extérieur. Définir une personne en semaines d’existence revient à peu près à juger des chefs d’œuvres littéraires en termes de quantité d’encre et de grammage, comme s’il pouvait exister une définition matérielle d’un chef d’œuvre littéraire. Mais, réciproquement, parce que la notion de personne n’est pas inscrite dans l’ADN, il serait aussi absurde de conclure qu’elle n’a aucune réalité ou que, parce qu’ils sortent d’une presse d’imprimerie qui n’est qu’une machine, les livres sont dénués de tout sens.
Il faut donc dire que le propre des vivants dans la nature est – en tant qu’ils représentent des individualités – d’introduire non pas des causes mais des fins. Impossible de comprendre la théorie de l’évolution en effet si l’on ne reconnait pas que les vivants ont leur propre prolongation pour fin. Mais si c’est là une raison, ce n’est pas une cause qui expliquerait l’organisation vivante. La fin ne conditionne pas l’origine et l’on ne trouvera aucune cause physique qui explique le fait que les vivants poursuivent leur propre prolongation, sauf à verser dans une « mystique de l’ADN » qui dote volontiers les gènes de la capacité de vouloir et de penser ! Au mieux trouvera-t-on quelques gènes ou d’autres éléments qui conditionnent des comportements favorisant leur prolongation.
Certes dira-t-on alors mais de même que nous voyons parce que nous avons des yeux, plutôt que nous avons des yeux pour voir, si le vivant poursuit sa propre prolongation, c’est parce qu’il est ainsi déterminé par son organisation. Il n’y a pas à le doter de quelque volonté transcendante au-delà. Or cela est juste sans doute. Une bactérie est son organisation et il n’y a pas à imaginer quelque « esprit » ou « âme » de la bactérie qui la déterminerait à la manière d’une problématique surconscience. Cela n’annule pourtant pas la « finalité » que l’on peut reconnaître à la vie bactérienne, qui est une raison, non une cause agissante. Ce qui revient à dire qu’avec la vie, la matière accède à une dimension de réalité individuelle et comme telle intellectuelle que ne possède pas le non-vivant – la frontière entre les deux pouvant d’ailleurs être poreuse sans doute.
Avec les êtres vivants apparaissent dans l’être des capacités de représentation et de réflexion. Réciproquement, l’intelligence est peut-être ce qui caractérise le plus proprement le vivant. Non que tous les vivants soient intelligents, bien sûr. Mais dans la mesure où les êtres vivants sont à eux-mêmes leur propre fin, ils ont considération d’eux-mêmes, ce qui définit l’intelligence, même si, avec la plupart des vivants, cette considération n’est ni consciente ni même pensée. Elle n’en traduit pas moins ce qui anime le vivant et le fait que, celui se posant pour fin, se pose également comme valeur.
Dans le monde physique, on ne trouvera pas de raisons à ce qui vit – la rose est sans pourquoi ! – seulement des causes, qui permettent d’en retracer l’apparition, la formation et d’en prédire le destin physique, comme pour tout ce qui est matière. Pour autant, sous son organisation matérielle, le vivant présente des caractères de spontanéité propre qui le distinguent au sein de la matière : il est organisé pour sa propre survie. Celle-ci n’est pas programmée. Elle est contingente et c’est là très précisément ce que le finalisme et le mécanisme ne comprennent pas : la vie, c’est la matière devenue contingente et singulière. Pour comprendre la vie, dès lors, les explications matérialistes en termes de causes directes ne suffisent plus. Il faut une raison : une finalité, qui est la poursuite par la vie de sa propre prolongation, de son propre épanouissement, par lequel le vivant gagne finalement, à travers certains vivants, comme les hommes, la conscience, la réflexion, la possibilité d’infléchir son propre destin. Il n’y a pas là un mystère mais une histoire, une évolution. Rapporter cette évolution, de manière finaliste, à quelque spontanéité propre des vivants reviendrait à la nier puisque cela reviendrait à inscrire dans l’ordre des causes directes (et de manière scientifiquement problématique) ce qui justement en émerge.
Encore une fois, cela ne veut surtout pas dire que le vivant échappe à l’ordre de la matière en quelque façon et ne peut être compris qu’en pensée. Penser la vie, c’est penser à une échelle où pratiquement rien ne pense. Et nous découvrir simplement vivant n’est certainement pas nous reconnaître, puisque c’est se découvrir injustifié et mû comme au-delà de nous – à travers l’irrésistible désir de nous prolonger, de profiter de nous-mêmes. C’est se découvrir poursuivant une fin qui n’est autre que nous-mêmes, sans savoir pourquoi. C’est se découvrir proprement impensable – particulièrement à travers les épreuves de la souffrance et de la mort, dans lesquelles, immédiatement, il y a des cris mais peu de mots, ceux-ci venant toujours trop tard et ne parvenant au mieux qu’à rattraper l’irrémédiable. Par là, comprendre la vie ne donne sans doute pas la clé de nous-mêmes, de notre existence mais peut en revanche convaincre de renoncer à chercher une telle clé qui expliquerait notre vie en nous situant au-delà d’elle. En ce sens, une philosophie de la vie pourrait bien avoir pour principal objet de souligner que nous ne sommes pas un mystère ; comme l’indique la Monadologie (1714) de Leibniz ; laquelle sera particulièrement présentée ici.
Consulter/Télécharger le texte (24 pages) : La monadologie
Ross Bleckner, 2001.